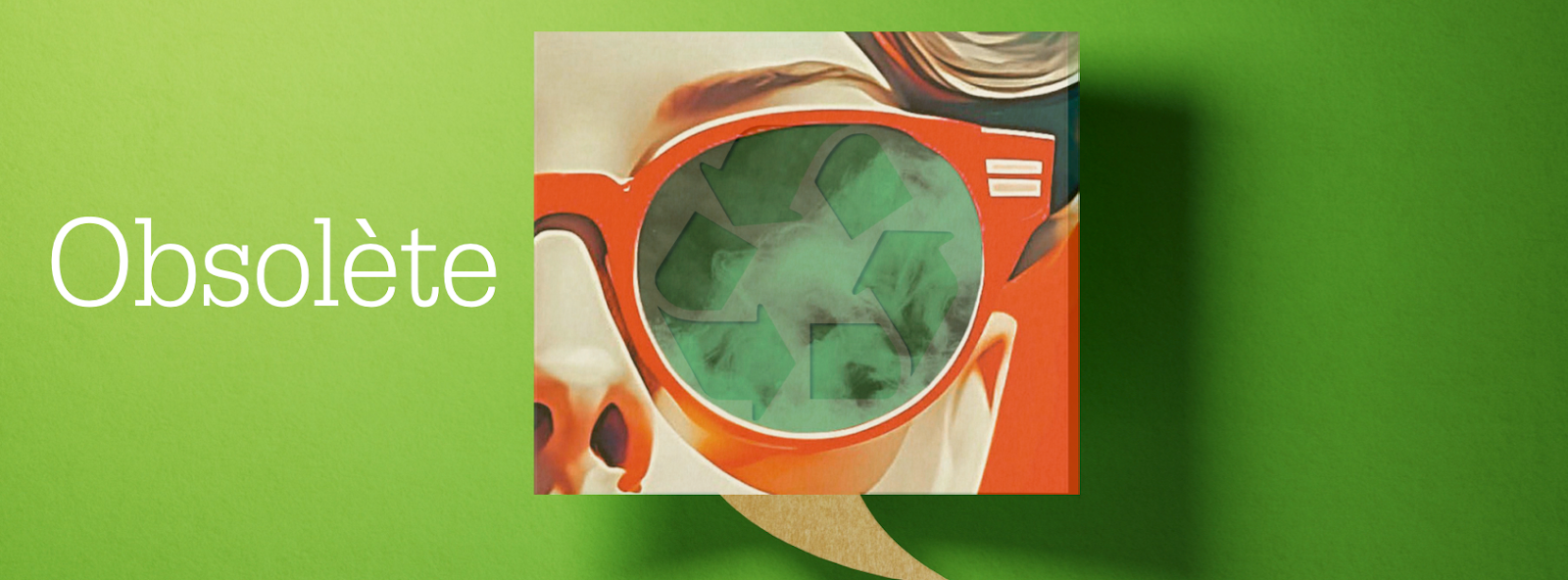|
| @Unifrance |
Pour le cinéaste Wim Wenders, cette question ne se pose pas.
C’est une certitude.
En 1982, dans le documentaire Chambre 666, il posait déjà cette question à seize réalisateurs : "Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir ? " Quarante ans plus tard, dans son documentaire Chambre 999, la cinéaste Lubna Playoust a utilisé le même dispositif pour reposer cette question à trente cinéastes contemporains présents à Cannes en 2022, dont Wim Wenders lui-même. Sa réponse est résumée dans le titre de cet article.
 |
| Lien vers le documentaire ici |
Selon lui, la révolution numérique n’a pas seulement mis en péril toutes formes d’expression artistique (cinéma, photographie, peinture, sculpture, écriture…), elle a envahi nos vies, nos habitudes. Des propos auxquels j’adhère et qui rejoignent celui d’Obsolète :
« Elle a érodé notre culture et a fortement annihilé l’idée de ce qu’est la vérité, » nous dit-il, « et aussi l’idée de ce qu’est la beauté. On est devenue une espèce en voie d’extinction et l’idée de bien commun a souffert de cette révolution numérique léthale. »
Voilà une parole forte que l’on entend peu sur les réseaux sociaux (et pour cause) ou dans les médias.
« Le numérique a dépassé les moyens techniques. Il n’a pas seulement modifié nos supports de créations ou de communication, il a révolutionné, contaminé notre quotidien, nos interactions sociales, remplacé ou détruit des métiers, des usages. »
Cette modification globale de nos existences et de notre place dans la société, ce qu’elle bouleverse sans chercher à faire la part des choses de chaque instant de notre vie, m'est insupportable. Voilà pourquoi j’ai décidé que dans deux siècles, nous étions parvenus à la maîtriser, à en canaliser les usages, à les raisonner.
 |
| @Myedit |
Une attraction de fête foraine
Wim Wenders, à propos de ce que sera cinéma dans le futur, imagine très précisément ce que j’ai écrit dans le roman, pages 283-284 :
« C’était une mélodie familière, rattachée à la fête foraine de la communauté des villages qui se tenait à l’automne, avant la saison des pluies et des tornades. Les attractions arrivaient par le train avec les forains, et tout le monde donnait un coup de main pour le montage et le démontage. Durant dix jours, dès le coucher du soleil, la fête déployait ses merveilles : des manèges mécaniques, actionnés par des vélos, emportés par la musique d’un orgue de foire, de nombreux stands parmi lesquels un tir à la carabine avec des fléchettes à ventouse auquel tous les adultes se bousculaient, un labyrinthe de miroirs d’où on ressortait avec quelques bleus, une boîte à illusions d’optique et ses lanternes magiques, un chasse-taupe que l’on remontait mécaniquement, une automate diseuse de bonne aventure aux yeux clignotants, une machine pour exercer sa force et faire sonner la cloche, un magicien sur son estrade, des autos tamponneuses grisantes, un cinéma d’antan qui projetait les images muettes, féeriques et burlesques des premiers films en noir et blanc, et des vendeurs de gaufres, de chichis, de barbes à papa et de guimauves aux blancs d’œufs montés en neige moelleuses comme des nuages, dont le vent charriait les parfums jusqu’au village. »
Wim Wenders : « Le cinéma était dédié à la beauté, à l’intelligence, à la culture de l’esprit et des sens, à la vérité, aux émotions construites à partir d’une narration. Tout cela disparait. Les langages, les cinématographies sont en train de disparaître. On parle d’érosion : ce n’est pas un phénomène climatique, c’est un phénomène culturel. Il a commencé depuis longtemps. »
 |
| @DR |
Raconter une histoire
Certes, le cinéma et la littérature, comme la photographie argentique, sont en voie d’extinction. Tout comme les métiers de critiques (art, cinéma, littérature) submergés par des vagues de publics critiques autoproclamés sur les réseaux sociaux.
Mais contrairement à Wim Wenders, je pense que nous n’avons pas fini de raconter des histoires. Nous aurons toujours besoin de l’humain, de l’artiste et de sa voix particulière, pour nous raconter des histoires avec des mots, des dessins, des images. C'est la manière de raconter et les outils pour le faire qui sont en train de changer.
L’intelligence artificielle est par essence plus proche de l’inexactitude, de la copie et du plagiat que de le perfection. A la différence de l’homme, elle fabrique à notre demande, sans comprendre ce qu’elle fabrique. Pour l'instant - mais qui sait ce qu'il en sera dans cinquante ans? - elle n'a pas de sensibilité à l'oeuvre qu'elle produit, et elle ignore ce que sont les émotions qu'elle est incapable de traduire autrement qu'en les singeant ou les copiant.
Oui, c’est arrivé plus vite qu’on ne le pensait.
Oui, comme nous le rappelle le cinéaste, la révolution numérique est mortelle. Elle engendre une consommation d’énergie pour le stockage des données qui met l’humanité en danger et en dépendance de ses besoins.
Oui, les réels sont des films plus sensoriels, plus resserrés qui tendent à satisfaire une satisfaction primaire de sensations au détriment de toute narration.
Oui, le spectateur est peu à peu habitué à des films flashs qui réduisent son champ de réflexion à la taille d’un timbre-poste : ça me plaît, ça m’existe, ça m’amuse, ça m’émeut ou pas.
Mais allons plus loin : dans deux siècles, ce qui aujourd’hui est une révolution numérique toxique sera de toute évidence totalement… obsolète! Et ce qui nous émerveille et nous excite aujourd’hui rejoindra demain les attractions de fête foraine, au même titre que le cinématographe.
On se lasse de tout, même du numérique.
« L’une des attractions les plus appréciées par les enfants proposait une immersion dans le métavers du Pays merveilleux. Munis d’un casque VR, ils évoluaient à l’intérieur d’une salle dans un univers élaboré à partir d’archives cinématographiques constituées de milliers de films d’animation et de dessins animés réalisés sans l’intervention d’un ordinateur. Les scénarios, jalonnés de clichés d’une autre époque, inspirés de contes plus datés encore, mettaient en scène d’adorables animaux ou de ravissantes princesses. Des personnages à la fois naïfs et charmants, dont les mésaventures relevaient d’une idéologie douteuse mais pleine de bons sentiments. Évoluer dans cet univers était hypnotique, délicieux comme le glaçage fondant d’un gâteau : le graphisme concentrait la grâce, la douceur, la volupté et la beauté d’un monde que, durant quelques minutes, on prenait pour la réalité.
Un joli pays dans lequel les enfants pouvaient aller rien qu’en ouvrant les yeux. »
(Extrait d’Obsolète, page 284)
 |
| @DR |